

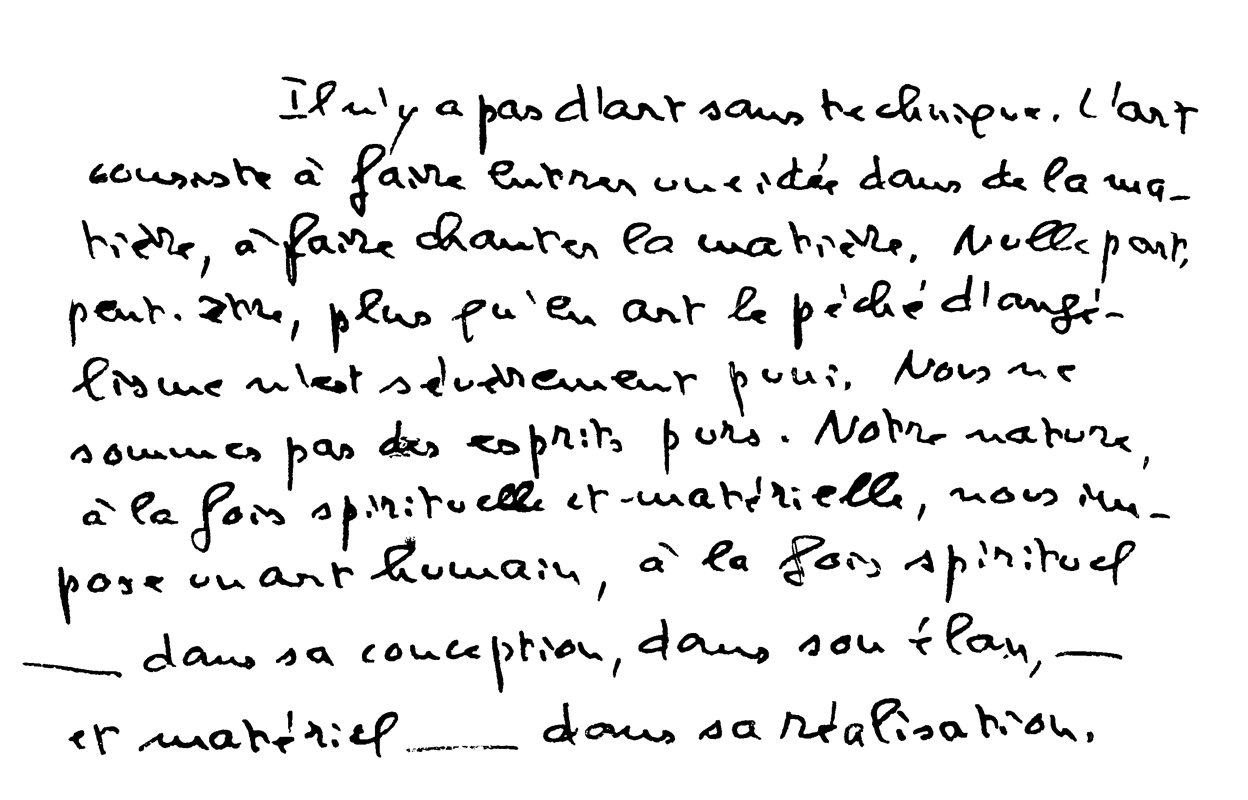
Chroniqueur à la Tribune de Lausanne de 1918 à 1958, Aloÿs Fornerod a eu une activité littéraire exceptionnelle, digne d’un Hector Berlioz! La lecture de ses chroniques est un régal. La plume, toujours élégante et vive, sait distribuer avec une égale conviction la louange et la réprobation, et cela avec une grande pénétration et une totale sincérité. Il tenait absolument à cette indépendance de jugement et d’expression et s’en explique dans son dernier article paru dans la Tribune de Lausanne:
Certains voudraient que le critique comprenne son rôle comme celui d’un avocat chargé de défendre ce qui survient, et qui suivrait le courant en l’expliquant, qui «marcherait avec son temps» et, flairant le succès, se mettrait du côté de ceux qui vont réussir. J’aurais eu l’impression de me déshonorer en agissant ainsi. [...] Le critique peut se tromper, et cela m’est sans doute arrivé, mais la vérité ne parviendrait pas à s’établir si l’on s’abstenait de critiquer, c’est-à-dire de juger. Il faut exprimer son opinion, bonne ou mauvaise, pour qu’il se fasse un tri et que ce qui est vrai soit séparé de ce qui est faux.
Tribune de Lausanne, 29 septembre 1958
Une condamnation? En voici une, et des plus féroces, non sur un artiste mais sur une œuvre, après un concert du Septembre musical de Montreux:
M. Nathan Milstein, le très célèbre violoniste, s’était produit dans le Concerto en ré majeur de Tchaïkovski, admirablement fait pour permettre au soliste de danser sur la corde raide. Mais quelle musique de cirque, grands dieux! [...] Comment voulez-vous qu’on vous dise si M. Nathan Milstein est un bel interprète, ce qui est fort possible, après ces acrobaties inutiles? Comment parler de son style puisqu’il a joué une œuvre qui n’en a pas? Tout ce qu’on peut dire avec certitude, c’est que M. Nathan Milstein est très exceptionnellement doué pour le violon, qu’il a l’oreille juste et qu’il n’a point de rhumatisme dans le bras droit ni dans la main gauche.
Tribune de Lausanne, 9 septembre 1953
Et voici un bel éloge de Jacques Ibert, paru dans la revue Choisir le 29 mars 1962:
Ainsi Jacques Ibert vient de nous quitter, et avec lui c’est un grand musicien de France qui disparaît. "Grand musicien" fera sursauter le lecteur imprégné de musique romantique, postromantique et avant-gardiste, car, justement, Jacques Ibert n’était ni romantique, ni «dodécaphoniste». Il était de tempérament, de goût et de choix, aussi classique qu’on peut l’être, si l’on admet, avec Eugène Marsan, qu’il y a un classicisme créateur et que, lorsqu’on dit classique, il ne faut pas nécessairement entendre académique, pompier et pantouflard.
Jacques Ibert aura traversé une époque fiévreuse et admiratrice de tous les excès sans perdre la tête et en écrivant une musique ordonnée, sensible, intelligente, pleine d’imagination, de sentiment et de rêve. Et s’il l’a osé et s’il l’a pu, c’est qu’il avait en lui ce qui permet de négliger un peu le monde extérieur et de sentir le besoin de donner une forme à sa pensée.
Citons encore une appréciation sur Stravinski après une audition de L’Oiseau de feu:
Ce chef-d’œuvre, qui restera certainement comme l’une des compositions les plus accomplies de son auteur et l’une des partitions les plus remarquables de notre époque. [...] Remarquons, en passant, que le Stravinski russe n’a jamais été dépassé ni même égalé par le Stravinski international et néoclassique. Il semble bien que la partie la plus consistante et la plus viable de sa production soit, en effet, celle qui se souvient des enfances du grand musicien. Les palaces internationaux ne lui ont rien valu.
Tribune de Lausanne, 9 septembre 1953
Au-delà des articles, Aloÿs Fornerod, professeur de théorie et compositeur, nourrit tout au long de son existence une réflexion profonde sur l'identité musicale du musicien romand, qui se traduit par de nombreuses conférences et la publication de plusieurs ouvrages d'essence musico-philosophique. Dans La Musique et le Pays en 1928 il écrit:
Un musicien de la Suisse romande aborde la composition avec une inquiétude que ne connaissent pas le Français ou l'Italien. Son origine glisse dans son esprit un doute stérilisant. Va-t-il chercher ses modèles dans l'œuvre des grands musiciens de France? Ou bien tentera-t-il une sorte de fusion de l'art latin et de l'art germanique? La plupart du temps, il hésite, et son hésitation entretenue par les préjugés courants, le promène de Paris à Berlin, de Berlin à Munich, de Munich à Vienne. Il meuble son esprit, mais la culture qu'il acquiert, au lieu de l'exciter à produire, le fige dans l'attitude d'un auditeur averti et impuissant.
La France? L'Allemagne? L'Italie? Le romantisme? Le classicisme? Le dodécaphonisme? Le folklorisme? Entre «néo» et «post», entre nord et sud, entre épaisseur et clarté, entre tradition et avant-garde, le compositeur suisse du début du 20e siècle ne sait où donner de la tête… et du cœur. Le débat est vif, les positions tranchées, les réponses subjectives. Le Vaudois plus encore que ses confrères alémaniques est déboussolé: la «grande» musique et même le chant populaire – rappelez-vous Jean-Bernard Kaupert! – lui a été offerte par des musiciens venus d'Allemagne. Et voilà que soudain c'est en France qu'il faut aller s'abreuver, à la source «naturelle» de sa langue. Qui croire? Comment ne pas en perdre son… latin?
Formé au Conservatoire de Lausanne (il étudie le violon chez Max Frommelt et l'harmonie chez Alexandre Denéréaz) mais surtout à la Schola Cantorum de Paris auprès de Vincent d'Indy (composition) et Auguste Sérieyx (contrepoint), Aloÿs Fornerod rejette violemment l'héritage romantique du 19e siècle – Debussy compris, dont il assimile l'impressionnisme musical au courant germanique. Il s'inscrit en cela dans la droite ligne de Gustave Doret, en guerre contre une idéologie germanique par trop conquérante à ses yeux et qui milite «pour notre indépendance musicale» (c'est le titre d'un recueil d'articles parus dans le journal La Suisse pendant la guerre qu'il préface en décembre 1919). En guise de fondements pour un renouvellement de l'art du 20e siècle, Fornerod prône un retour aux sources mélodiques (en particulier le grégorien) et à l'écriture contrapuntique (l'exemple de la Renaissance palestrinienne). Il ne peut s'entendre avec des personnalités comme Ernest Ansermet qui, à travers les programmes qu'il dessine pour son Orchestre de la Suisse Romande (OSR), se bat pour une large ouverture des «frontières» et écrit en 1919 déjà (dans la Revue romande): «La musique, dans l'état où l'a amenée la civilisation moderne, ne peut plus enfermer sa vie dans les limites d'un pays. Produit d'une personnalité définie, liée dans son éclosion à la race qui l'a vue naître, déterminée par elle, elle est internationale, ou plutôt extranationale, dans sa portée.»
La fracture est consommée. S'il fallait citer un événement, ce serait la fête annuelle 1923 de l'Association des musiciens suisses (AMS) qui se tient à Genève. L'AMS polarise toutes les oppositions. Deux personnes les incarnent cette année-là. D'un côté, Ernest Ansermet, avocat d'une vie musicale plurielle et cosmopolite, portée par des institutions comme l'OSR mais aussi des associations de musique de chambre comme «Les Nouvelles Auditions» et «Le Carillon» à Genève et «La Clarinette» à Lausanne. De l'autre, Gustave Doret, partisan d'un retrait identitaire gage d'authenticité, qui cite à qui veut l'entendre ces mots lourds de sens que lui a confiés Gabriel Fauré peu de temps auparavant (reproduits dans son ouvrage de souvenirs Temps et Contretemps publié à Fribourg en 1942): «À la vérité, le danger est imminent pour vous d'être submergés par tant d'influences extérieures dont il faut vous dégager à tout prix. À notre époque où, même parmi les artistes, il en est qui veulent nier les nationalités et la puissance de la race dans le domaine de l'art, à notre époque où les procédés les plus affairistes nous envahissent, prenez garde!»
Pensez donc la réaction de Doret lorsque Ansermet propose durant la fête que les membres de l'AMS fassent automatiquement partie de la Société internationale de musique contemporaine (SIMC)! La proposition est non seulement rejetée mais elle entraînera la fondation d'une section suisse autonome de la SIMC, toujours en activité. «Bien que Doret ne soit guère explicite sur les arguments qui ont motivé son opposition, note Philippe Dinkel, actuel directeur de la Haute école de musique de Genève, il est aisé de lire entre les lignes une méfiance toute helvétique à l'égard de l'extérieur et, plus singulièrement, un refus très net de rattacher la musique suisse romande à un courant plus vaste que la tradition spécifiquement française, seule garante de son identité culturelle.»
Que fait le Conservatoire de Lausanne? Contrairement à ce que voudraient croire certains, il ne s'érige pas en forteresse des traditions vaudoises mais poursuit avec conviction son œuvre d'intérêt général, ne forçant le destin ni dans un sens ni dans l'autre, laissant la porte ouverte à toutes les initiatives qu'il juge de qualité. On est loin, naturellement, des Ateliers de musique contemporaine ou des coproductions d'aujourd'hui avec la Société de musique contemporaine de Lausanne (SMC), mais on assiste par exemple à la venue d'Igor Stravinski le 8 novembre 1919, invité à présenter en personne son œuvre pour piano entre les murs de l'institution. Les compositeurs vivants sont eux aussi régulièrement à l'honneur lors des séances musicales; certaines leur sont entièrement dédiées comme l'«audition annuelle des compositeurs vaudois», les «auditions de musique nouvelle» (qui voient la présentation le 22 mai 1918 d'un programme consacré entièrement à l'œuvre d'Ernest Ansermet), ou encore de ce «concert d'œuvres de compositeurs du Conservatoire» mis sur pied le 4 décembre 1941.
Aloÿs Fornerod figure souvent sur ces affiches, au même titre qu'Emile-Robert Blanchet – «un de nos premiers compositeurs non populaires» pour Jean Apothéloz! – ou son disciple et ami Henri Stierlin-Vallon. Il donne des conférences, signe de nombreux articles, rédige des livres et compose une musique qui, mieux que les mots, parle pour sa cause. Son camarade d'études à la Schola, Henri Gagnebin, qui dans l'intervalle a pris la direction du Conservatoire de Genève, applaudit des deux mains: «D'entre les compositeurs romands, dit-il lors d'une séance de l'AMS à Zurich, il est celui qui a renié avec le plus de force la fusion germano-française propre à créer un art suisse ou européen, mirage qui tentait fort nos esthètes du commencement du siècle.» Fornerod est aussi un professeur respecté: parallèlement à son enseignement à l'Institut de Ribaupierre, il donne des cours d'histoire de la musique, de basse chiffrée, d'harmonie pratique et de composition au Conservatoire de Lausanne, qu'il quitte en 1947 – fâché, dit-on, de ne pas avoir été choisi pour succéder à son maître Denéréaz à la tête de la classe d'harmonie. Il finira sa carrière à Fribourg, où il dirigera le Conservatoire de 1954 jusqu'à sa mort en 1965. Alfred Pochon a préféré Hans Haug à Fornerod. Faut-il lire dans ces choix professoraux la volonté de la direction d'appuyer tel ou tel courant? Je ne m'y hasarderai pas, me contendant de placer face à face Aloÿs Fornerod, professeur de composition de 1945 à 1947, Rainer Boesch, directeur de 1968 à 1972, et William Blank, professeur d'analyse contemporaine depuis 2001 et de me dire qu'une institution capable de faire siennes des personnalités aussi contrastées est une institution vivante!
Extrait de: Antonin Scherrer, «Conservatoire de Lausanne, 1861-2011», Infolio, 2011.